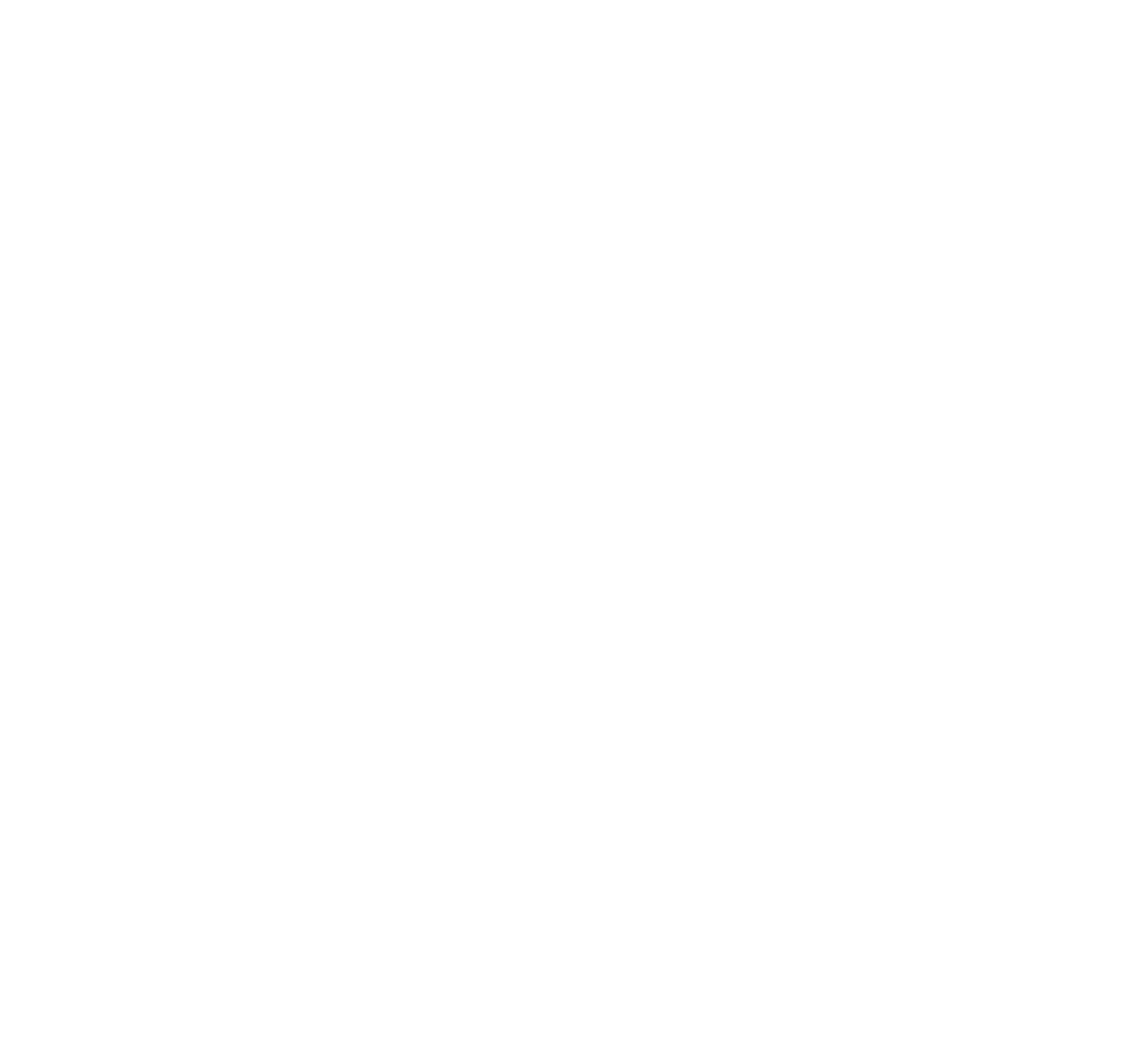RENCONTRE DU GPM PROTECTION DES CULTURES CHEZ ARVALIS
Le 24 juin 2025, les membres du Groupe Produit Marché (GPM) « Protection des cultures » d’Axema se sont réunis au sein du centre de recherche d’Arvalis à Boigneville. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique claire : resserrer les liens entre nos deux structures, partager nos expertises, nos priorités, et créer des synergies au service d’une protection des cultures à la fois efficace, raisonnée et durable.
Arvalis – Institut du végétal – est un acteur central de la recherche appliquée agricole en France. Institut technique agricole piloté par les producteurs, il accompagne les filières des grandes cultures (blé, maïs, orge, lin, pomme de terre, fourrages…) en produisant des références neutres et indépendantes sur les pratiques agricoles, les innovations et la transition agroécologique. Arvalis c'est plus de 450 collaborateurs – dont 220 ingénieurs et 160 techniciens – répartis sur 26 stations d’expérimentation, 350 agricultrices et agriculteurs participent activement à ses orientations régionales. L'institut conduit chaque année plus de 100 000 parcelles d’essais à travers le territoire. 80 % de la surface agricole française est concernée par ses travaux, au service de missions qui visent à concilier performance économique, adaptation aux marchés, résilience face aux aléas et contribution positive aux enjeux environnementaux.
Arvalis travaille à la production de références techniques indépendantes sur les grandes cultures, avec un objectif : accompagner les producteurs dans la performance technico-économique et environnementale de leurs systèmes de culture.
Une protection des cultures en pleine mutation
Les produits phytopharmaceutiques sont de plus en plus nombreux à disparaître du marché, sous l’effet de la réglementation européenne. En 17 ans, la France a perdu plus de 100 substances actives, soit une baisse de 25 %. En parallèle, le nombre de produits commerciaux autorisés a chuté de plus de 45 %. Alors qu’il restait 383 substances actives autorisées au niveau européen en février 2025, seules environ 300 se retrouvaient effectivement dans des produits autorisés en France.
Et la tendance s’accélère : 231 substances actives sont actuellement en cours de réévaluation pour la période 2025-2027. La majorité d’entre elles est potentiellement menacée, tandis que l’autorisation de nouvelles substances devient de plus en plus complexe, notamment en raison de l’élargissement des critères de risque (biodiversité, qualité de l’air et des sols, métabolites, PFAS, effets cocktails…). Ce durcissement du cadre réglementaire impose une réinvention des stratégies de protection, dans laquelle les agroéquipements ont un rôle déterminant à jouer. Dans ce contexte Arvalis a engagé un vaste programme de protection intégrée des cultures (PIC). Lors de cette rencontre, Arvalis a détaillé ce programme avec nos industriels.
C'est quoi le programme PIC
L'objectif du programme : réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques tout en garantissant une protection efficace et durable des cultures. Plutôt que de raisonner en termes de "remplacement produit par produit", le programme propose une logique systémique articulée autour de trois piliers : prévenir, diagnostiquer, soigner, en mobilisant l’ensemble des leviers disponibles, dont les agroéquipements, les pratiques agronomiques, la génétique, ou encore les outils numériques.
Le programme PIC repose d’abord sur une liste de plus de cinquante bioagresseurs prioritaires, identifiés par culture, qui structurent les travaux de recherche et les expérimentations menées dans les stations d’Arvalis. Ce ciblage permet de concentrer les efforts sur les situations les plus critiques pour les agriculteurs, et de développer des solutions adaptées aux réalités de terrain.
Les travaux menés par Arvalis s’organisent autour de deux volets complémentaires :
- Produits phytopharmaceutiques, incluant le biocontrôle, mais aussi l’optimisation de l’application des produits (ciblage, précision, réduction des doses, positionnement, etc.) ;
- Leviers alternatifs, tels que les pratiques agronomiques (rotations, date de semis, couverts), la sélection variétale, les outils mécaniques de lutte, ou encore la biodiversité fonctionnelle.
Les agroéquipements jouent un rôle transversal dans l’ensemble du programme PIC. Ils permettent d’activer concrètement les leviers identifiés, que ce soit pour mettre en œuvre les pratiques de prévention, améliorer le diagnostic ou optimiser les soins.
On retrouve notamment :
- Des outils pour les pratiques agronomiques : semoirs adaptés, broyeurs, matériels de gestion des couverts ou des résidus ;
- Des équipements de lutte physique : bineuses, herses, outils thermiques, effaroucheurs ;
- Des technologies de pulvérisation de précision, permettant une application ciblée et raisonnée des produits ;
- Des solutions pour le biocontrôle : épandeurs de macro-organismes, pulvérisation spécifique ;
- Des outils pour l’implantation mécanisée de plantes ;
- Des dispositifs de diagnostic embarqué : capteurs, caméras, pièges connectés.
À cela s’ajoutent la robotique, les outils de guidage, la collecte et l’analyse de données, qui renforcent l’efficience des interventions.
Une collaboration renforcée entre recherche et industrie
Cette journée a permis aux industriels de mieux comprendre les besoins de terrain exprimés par les agriculteurs via les stations d’Arvalis, notamment dans les principales cultures concernées (maïs, céréales, prairies, lin, pomme de terre…). À travers la visite du site de Boigneville et les échanges techniques, les membres d’Axema ont pu découvrir les travaux sur la pulvérisation de précision, l’évaluation des matériels alternatifs ou encore les expérimentations sur la gestion des bioagresseurs. Cette collaboration est d’autant plus stratégique que les agroéquipements sont aujourd’hui l’un des principaux leviers disponibles pour maintenir la productivité tout en réduisant l’usage des intrants (solutions de pulvérisation de précision, d’optimisation de la dose, de modulation intra-parcellaire, ou encore de désherbage mécanique assisté par capteurs).
Les discussions ont également permis d’identifier les combats à mener collectivement : faire reconnaître la valeur des agroéquipements dans les politiques publiques (Plan Écophyto, soutien à l’innovation, réglementations européennes), construire une approche plus systémique de la protection (au-delà de la seule chimie), et soutenir l’expérimentation de terrain comme socle de la transition.
Qu’entend-on par protection des cultures ?
La protection des cultures désigne l’ensemble des moyens permettant de préserver les plantes cultivées des bioagresseurs : maladies, ravageurs, adventices. Longtemps dominée par une approche chimique, cette protection évolue aujourd’hui vers des solutions plus intégrées, combinant :
- leviers génétiques (variétés résistantes),
- leviers agronomiques (rotations, couverts…),
- biocontrôle,
- et bien sûr des outils mécaniques ou numériques innovants.
POUR ALLER PLUS LOIN
Ce projet, porté par l'INRAE et dont Axema est partenaire, vise à repenser la gestion des adventices dans le cadre du Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA).
🔗 Montoldre : au cœur de l'innovation agricole
Retour sur la visite du Conseil d'administration d'Axema à l' AgroTechnoPôle de Clermont-Ferrand, une infrastructure unique portée par l'INRAE et l'Institut Agro. De la robotique au désherbage alternatif, ce site incarne la coopérations entre laboratoires, agriculteurs et constructeurs.